
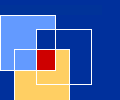
Module 1 — Pour une
rédaction efficace
| Guide d'étude | Module 1 | Module 2a | Module 2b |
Le genre
Le BIT accorde une importance capitale à l’utilisation d’un langage neutre relativement au genre. En effet, encore tout récemment, des consignes de rédaction prescrivaient d’éviter tout langage discriminatoire et sexiste dans la communication écrite. En conséquence, vous devriez utiliser un langage non sexiste, c’est-à-dire dans lequel les femmes et les hommes sont traités également, indifféremment de leur genre.
La discrimination liée au genre peut prendre différentes formes. Ainsi, les femmes sont souvent « invisibles » dans la langue. Cette situation est due au fait que le genre masculin est fréquemment utilisé pour représenter à la fois les genres masculin et féminin. Qui ne se souvient pas de la formule « le masculin l’emporte sur le féminin », si populaire dans les règles d’accord de l’adjectif qualificatif et du participe passé en français?
Plus subtilement, les femmes sont également absentes des illustrations et des exemples. Effectivement, quand vient le temps de citer ou d’illustrer des personnes de pouvoir, ce sont généralement des photos ou des illustrations d’hommes qui sont utilisées. Il faut donc faire preuve de vigilance en cours de rédaction.
Féminisation des titres
Relativement au genre des appellations d’emploi, l’Office québécois de la langue française recommande l’utilisation des formes féminines dans tous les cas possibles :
- à l’aide de la règle courante de formation du féminin commun, par exemple : couturière (couturier), infirmière (infirmier), avocate (avocat);
- à l’aide du terme épicène, c’est-à-dire d’un mot qui désigne aussi bien le masculin que le féminin, marqué par le déterminant féminin, par exemple : une journaliste, une architecte, une ministre;
- par la création spontanée d’une forme féminine qui respecte la morphologie de la langue française, par exemple : députée, chirurgienne, praticienne;
- par l’adjonction du mot « femme », par exemple : femme-magistrat, femme-chef d’entreprise, femme-ingénieur.
Utilisation des titres « madame » et « mademoiselle »
L’utilisation du titre de civilité « mademoiselle » tend à vieillir; on lui préfère « madame », sauf indication contraire de l’intéressée.
Il est à noter que « madame » s’écrit en toutes lettres dans les formules de politesse et de salutation d'une lettre. Ce titre sera abrégé quand il est accompagné du patronyme et que l’on ne s’adresse pas directement à la personne, par exemple : « Mme Laforest sera présente à la réunion ».