
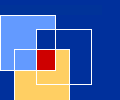
Module 2b —
Rédaction de rapports
et de documents
structurés
| Guide d'étude | Module 1 | Module 2a | Module 2b |
Les introductions
Lorsqu’un lecteur, une lectrice, prend le temps de lire un rapport, il y a fort à parier qu’il insérera cette tâche dans un programme déjà chargé. En conséquence, il souhaite obtenir rapidement les réponses à ses questions. C’est dans ce but que l’introduction doit être construite et constituer une entrée en matière qui éveille l’attention, suscite l’intérêt et invite à poursuivre la lecture. On y précise les objectifs du rapport avec concision et clarté; on doit également y indiquer l’origine du mandat, les limites et l’étendue du rapport.
Idéalement, mais facultativement, l’introduction compte trois paragraphes ou trois parties distinctes.
- Sujet amené
Dans la première partie, le contexte dans lequel le rapport s’inscrit est développé; il s’agit d’exposer la situation générale qui a motivé la rédaction de ce rapport.
- Sujet posé
La deuxième partie expose les objectifs du document; vous créez ainsi des attentes chez votre destinataire, attentes que vous devez satisfaire.
- Sujet divisé
La dernière partie de l’introduction fournit l’organisation du rapport, sa structure; de cette façon, le message véhiculé a de meilleures chances d’être compris.
Il s’agit donc encore une fois d’une structuration « du général au particulier », schématiquement représentée par une pyramide inversée.
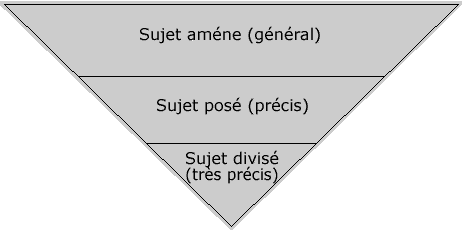
Figure 3
La structuration d’introduction dite de la « pyramide inversée ».
En somme, l’introduction vise trois buts de première importance, un par partie : 1) situer le contenu du rapport dans un contexte élargi, c’est-à-dire amener le sujet; 2) présenter clairement l’objectif du rapport en mentionnant l’étendue et les limites du document, c’est-à-dire poser le sujet; 3) exposer l’organisation du rapport, c’est-à-dire diviser le sujet.
- Situer le contenu du rapport dans un contexte élargi
Il faut partir d’un contexte plus large que le sujet propre au rapport pour ensuite diriger habilement le ou la destinataire vers le but visé : cette étape est essentielle pour établir le contact. La longueur et la profondeur du propos seront guidées par le profil du destinataire, préalablement élaboré. Il faut cependant éviter de partir d’une idée trop générale, trop banale ou trop abstraite.
- Présenter clairement l’objectif du rapport en mentionnant l’étendue et les limites du document
C’est l’élément fondamental de l’introduction. On mentionne clairement le mandat du document, on cite les objectifs du document, les problèmes à résoudre, l’objet du rapport. Des attentes sont ainsi créées chez le lecteur ou la lectrice.
- Exposer l’organisation du rapport
À cette étape, il s’agit de dévoiler les idées directrices développées dans son rapport et les liens qui les unissent : il faut faire preuve de simplicité.
De plus, l’introduction sert à :
- susciter l’intérêt pour le contenu du rapport;
- révéler des informations documentaires sur le sujet traité.
Il n’y a rien de tel qu’un exemple pour illustrer des notions. Lisez attentivement l’exemple suivant; il est tiré d’un rapport de la commission mondiale sur la dimension sociale de la mondialisation.
Introduction La recherche d’une mondialisation juste créant des opportunités pour tous dominera les affaires internationales au cours des dix années à venir. Que l’on considère le problème sous l’angle de la stabilité sociale et politique et de la sécurité ou du point de vue de ceux, très nombreux, pour qui les avantages de la mondialisation sont aujourd’hui un mirage, on ne peut balayer d’un revers de main les préoccupations bien réelles concernant l’équité et les opportunités. C’est pourquoi, dans mon rapport, je commence par passer en revue les différentes manières pour le BIT de développer une recommandation fondamentale de la commission — celle de faire du travail décent un objectif mondial et non pas simplement un objectif de l’Organisation. Je procède ensuite à un examen plus approfondi de six grands thèmes : les politiques nationales à adopter face à la mondialisation, le travail décent dans les systèmes de production mondiaux, la cohérence des politiques mondiales en matière de croissance, d’investissement et d’emploi, l’instauration d’un socle socio-économique, l’économie mondiale et les mouvements transfrontières de personnes, et enfin le renforcement du système des normes internationales du travail. Je conclus par quelques réflexions sur les mesures que le BIT pourrait prendre pour répondre à l’appel lancé par la commission en faveur d’un renforcement par le système multilatéral de la participation et de la responsabilité, en mobilisant le tripartisme mondial de façon à contribuer pleinement aux efforts entrepris pour donner une dimension sociale à la mondialisation. |
Reprenons cette introduction et divisons‑la selon la structure dont il a été question précédemment.
Introduction |
1. Situation du contenu du rapport dans un contexte élargi Sujet amené La recherche d’une mondialisation juste créant des opportunités pour tous dominera les affaires internationales au cours des dix années à venir. Que l’on considère le problème sous l’angle de la stabilité sociale et politique et de la sécurité ou du point de vue de ceux, très nombreux, pour qui les avantages de la mondialisation sont aujourd’hui un mirage, on ne peut balayer d’un revers de main les préoccupations bien réelles concernant l’équité et les opportunités. |
2. Présentation claire de l’objectif du rapport en mentionnant l’étendue et les limites du document Sujet posé 3. L’organisation du rapport Sujet divisé C’est pourquoi, dans mon rapport, je commence par passer en revue les différentes manières pour le BIT de développer une recommandation fondamentale de la commission – celle de faire du travail décent un objectif mondial et non pas simplement un objectif de l’Organisation. Je procède ensuite à un examen plus approfondi de six grands thèmes : les politiques nationales à adopter face à la mondialisation, le travail décent dans les systèmes de production mondiaux, la cohérence des politiques mondiales en matière de croissance, d’investissement et d’emploi, l’instauration d’un socle socio-économique, l’économie mondiale et les mouvements transfrontières de personnes, et enfin le renforcement du système des normes internationales du travail. Je conclus par quelques réflexions sur les mesures que le BIT pourrait prendre pour répondre à l’appel lancé par la commission en faveur d’un renforcement par le système multilatéral de la participation et de la responsabilité, en mobilisant le tripartisme mondial de façon à contribuer pleinement aux efforts entrepris pour donner une dimension sociale à la mondialisation. |
Dans l’exemple qui précède, l’auteur a fait d’une pierre deux coups en présentant le sujet posé et le sujet divisé dans le même paragraphe.